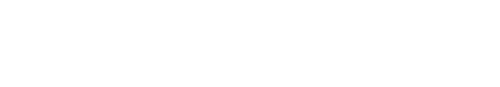27722601
Serpent d'Océan de Huang Yong Ping, fonte d'aluminium, 2012, sculpture monumentale, L. 128 m, H. 3 m, 284 vertèbres, création pérenne dans le cadre du Parcours Estuaire. Saint-Brevin-les-Pins, Pointe de Mindin, Loire-Atlantique.
Descripción
Mapa Mental por Corinne Bourdenet Vicaire, actualizado hace más de 1 año
Más
Menos
|
|
Creado por Corinne Bourdenet Vicaire
hace más de 3 años
|
|
Resumen del Recurso
Serpent d'Océan de Huang Yong Ping, fonte
d'aluminium, 2012, sculpture monumentale, L.
128 m, H. 3 m, 284 vertèbres, création pérenne
dans le cadre du Parcours Estuaire.
Saint-Brevin-les-Pins, Pointe de Mindin,
Loire-Atlantique.
- Questionnements artistiques transversaux : L’art, les sciences et les technologies
- Assimilation et appropriation de technologies pour créer (modélisation 3D)
- Assimilation et appropriation de technologies pour créer (modélisation 3D)
- Questionnements artistiques transversaux : Mondialisation artistique
- Médiation et diffusion autour de l'oeuvre
- Mondialisation : marqueurs de culture
occidentale et orientale
- Créer dans l’itinérance du voyage personnel, d’une
carrière artistique, d’un exil
- Relier les dimensions locales et
mondiales des ressources, des
pratiques, des cultures
- Hybridation des cultures dans leur diversité
artistique, historique et géographique
- Médiation et diffusion autour de l'oeuvre
- Questionnements artistiques transversaux : Artiste et société
- Oeuvre de commande :
projet "Le Voyage à
Nantes"
- Compagnie Royale de Luxe
- Compagnie Royale de Luxe
- Artiste exilé : reconnaissance artistique en jeu
- Artiste engagé politiquement,
artistiquement, écologiquement,
philosophiquement
- Liu Bolin : la politique et la censure, la
tradition et la culture chinoise, la société
de consommation et la liberté de la
presse. 2005, première série « Hiding in
the City » (Se cacher dans la ville)
- Barbara Kruger, Untitled (Questions),
1990/2018, MOCA, Los Angeles - Espace public
- Liu Bolin : la politique et la censure, la
tradition et la culture chinoise, la société
de consommation et la liberté de la
presse. 2005, première série « Hiding in
the City » (Se cacher dans la ville)
- Oeuvre de commande :
projet "Le Voyage à
Nantes"
- Projet (projeter)
- L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre
- Projet de l’œuvre :
modalités et moyens du
passage du projet à la
production artistique,
diversité des approches.
- Structuration d’une intention et d’un
projet en vue de réaliser l’oeuvre :
fonctions et potentialités variées des
étapes du processus de création…
- Langages et supports de communication
de l’intention ou du projet : dessins
préparatoires, maquettes, simulations
numériques, photomontages…
- Projet de l’œuvre :
modalités et moyens du
passage du projet à la
production artistique,
diversité des approches.
- L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre
- La représentation, ses langages, moyens
plastiques et enjeux artistiques
- Rapport au réel : mimesis,
ressemblance, vraisemblance et valeur
expressive de l’écart.
- Le squelette plutôt que l'animal complet. Mobile Matrix
de Gabriel Orozco, 2006, mine de plomb (graphite) sur
squelette de baleine grise, 196 x 1089 x 266 cm. Mexico.
- Le squelette plutôt que l'animal complet. Mobile Matrix
de Gabriel Orozco, 2006, mine de plomb (graphite) sur
squelette de baleine grise, 196 x 1089 x 266 cm. Mexico.
- Représentation et création : reproduction, interprétation, idéalisation,
approches contemporaines, apports de technologies…
- Moyens plastiques et registres de représentation : volonté de
fidélité ou affirmation de degrés de distance au référent…
- Rapport au réel : mimesis,
ressemblance, vraisemblance et valeur
expressive de l’écart.
- La figuration (oeuvre figurative)
- Rhétoriques de l’image figurative : symbolisation,
allégorie, métaphore, métonymie, synecdoque…
- Oeuvre et symbole emblématiques du travail de Huang
Yong Ping : plusieurs versions avec le serpent, ré-emploi,
variantes, série, déclinaison, répliques, ...
- Dialogues entre narration figurée, temps, mouvement et lieux : temps et
mouvement réels ou suggérés, temps de la production, de la
présentation, de la réception, l’éphémère, mouvement du spectateur…
- Vanité contemporaine : symbolique du temps qui
passe (marée, aluminium se patine, mue du serpent)
- Urs Fischer , Untitled, 2011, Cire, pigments, mèche, acie,
Dimensions variables, Installation à ‘ILLUMInations’,
Arsenale, Biennale de Venise, 2011
- Urs Fischer , Untitled, 2011, Cire, pigments, mèche, acie,
Dimensions variables, Installation à ‘ILLUMInations’,
Arsenale, Biennale de Venise, 2011
- Rapport au temps : pérenne mais évolutive
- Rhétoriques de l’image figurative : symbolisation,
allégorie, métaphore, métonymie, synecdoque…
- Réalisation monumentale : installation, sculpture à
échelle du paysage, en dialogue avec lui
- La matière, les matériaux et la
matérialité de l’œuvre
- Propriétés de la matière et des
matériaux, leur transformation : états,
caractéristiques, potentiels plastiques.
Valeur expressive des matériaux :
attention aux données matérielles et
sensibles de l’œuvre, primauté du
langage plastique des matériaux…
- Question de l’authenticité de l’oeuvre :
valeurs artistiques, sociales, symboliques de
la matérialité et leurs évolutions…
- Valeur artistique de la réalité
concrète d’une création plastique :
présence physique de l’oeuvre,
- Propriétés de la matière et des
matériaux, leur transformation : états,
caractéristiques, potentiels plastiques.
Valeur expressive des matériaux :
attention aux données matérielles et
sensibles de l’œuvre, primauté du
langage plastique des matériaux…
- Petit Lexique de l’Art Contemporain, Robert Atkins, ABBEVILLE PRESS Installation : dans l’art contemporain, le mot installation désigne des œuvres
conçues pour un lieu donné, ou du moins adapté à ce lieu. Ses divers éléments constituent un environnement qui sollicite une participation plus
active du spectateur. Pour éviter les connotations statiques, certains artistes préfèrent parler de dispositifs. En règle générale, l’installation échappe
au marché de l’art, même si on peut en avoir quelques unes exposées en permanence dans certaines collections de musées. Elles sont présentées
pendant une courte période, puis démontées et ne subsistent plus que par des documents photographiques
- La matière, les matériaux et la
matérialité de l’œuvre
- La présentation de l’œuvre
- In Situ : rapport au lieu = histoire écologique et
économique de l’Estuaire (civelle, pêche, port
industriel, transport maritime et fluvial)
- Petit Lexique de l’Art Contemporain, Robert Atkins,
ABBEVILLE PRESS In situ : une œuvre in situ est
exécutée en fonction du lieu où elle est montrée, pour y
jouer un rôle actif. Elle revêt souvent la forme de
l’installation, mais peut se limiter à une intervention plus
discrète de l’artiste, telle que l’apposition d’une plaque
sur un mur, voire de quelques coups de pinceau
seulement. La notion de dialogue entre l’acte artistique
et son site, développée comme un artiste tel que Daniel
Buren, a pris une extension particulière avec le Land Art.
- Petit Lexique de l’Art Contemporain, Robert Atkins,
ABBEVILLE PRESS In situ : une œuvre in situ est
exécutée en fonction du lieu où elle est montrée, pour y
jouer un rôle actif. Elle revêt souvent la forme de
l’installation, mais peut se limiter à une intervention plus
discrète de l’artiste, telle que l’apposition d’une plaque
sur un mur, voire de quelques coups de pinceau
seulement. La notion de dialogue entre l’acte artistique
et son site, développée comme un artiste tel que Daniel
Buren, a pris une extension particulière avec le Land Art.
- Interdisciplinarité artistique : Arts plastiques et paysage
- Art dans la Nature
- Spiral Jetty de Robert Smithson,1970 : longue jetée de 457
m de long et de cinq mètres de large environ au bord du
Grand Lac Salé. Elle fut engloutie par une brusque montée
des eaux en 1972.
- Surrounded Islands de Christo et Jeanne-Claude, 1983 :
gigantesques nénuphars de tissu rose autour des îles de Floride,
pendant 2 semaines
- Sculpture dans paysage : La Colonne sans fin de
Constantin Brancusi, à Târgu Jiu, vers 1938
Epreuve gélatino-argentique, 24 x 18 cm
Photographie de l'artiste. centre Pompidou Paris
- Spiral Jetty de Robert Smithson,1970 : longue jetée de 457
m de long et de cinq mètres de large environ au bord du
Grand Lac Salé. Elle fut engloutie par une brusque montée
des eaux en 1972.
- Art dans la Nature
- Environnement et usages de l’œuvre ou de l’objet
- Liens entre partis-pris et formes d’un paysage : approches
sensibles impliquant les questions de l’échelle, du volume, de
l’espace selon la destination d’un projet ou d’une réalisation…
- Prise en compte des caractéristiques des
espaces
- Accentuation de la perception sensible de l’oeuvre :
mobilisation des sens, du corps du spectateur…
- Claes OLDENBURG et sa compagne,
Coosje VAN BRUGGEN, Bicyclette
ensevelie, œuvre installée en novembre
1990 au Parc de la Villette, Paris, acier,
aluminium, plastique renforcé par des
fibres, peinture émail de polyuréthane,
quatre éléments, dans une zone d'environ
: 46 x 21,7 m (roue : 2,8 x 16,3 x 3,2 m,
guidon et sonnette : 7,2 x 6,2 x 4,7 m, selle:
3,5 x 7,2 x 4,1 m, pédale: 5,0 x 6,1 x 2,1 m).
- Claes OLDENBURG et sa compagne,
Coosje VAN BRUGGEN, Bicyclette
ensevelie, œuvre installée en novembre
1990 au Parc de la Villette, Paris, acier,
aluminium, plastique renforcé par des
fibres, peinture émail de polyuréthane,
quatre éléments, dans une zone d'environ
: 46 x 21,7 m (roue : 2,8 x 16,3 x 3,2 m,
guidon et sonnette : 7,2 x 6,2 x 4,7 m, selle:
3,5 x 7,2 x 4,1 m, pédale: 5,0 x 6,1 x 2,1 m).
- In Situ : rapport au lieu = histoire écologique et
économique de l’Estuaire (civelle, pêche, port
industriel, transport maritime et fluvial)
- La monstration et la diffusion de l’œuvre,
les lieux, les espaces, les contextes
- Contextes d’une monstration de
l’œuvre : lieux, situations, publics. Les
lieux non spécialisés et les monstrations
éphémères : espace naturel, public,
non-institutionnel, intégration à un
parcours artistique
- Espace public, nature comme lieu
d'exposition (hors galerie et musée)
- Mises en espace, mises en scène
pour un public large, de tout
âge, spécialisé et non-spécialisé
- Contextes d’une monstration de
l’œuvre : lieux, situations, publics. Les
lieux non spécialisés et les monstrations
éphémères : espace naturel, public,
non-institutionnel, intégration à un
parcours artistique
- La réception par un public
de l’œuvre exposée,
diffusée ou éditée
- Élargissement des modalités et
formes de monstration, de réception
de l’oeuvre : diversité des relations
entre oeuvre et spectateur de la
contemplation à l’action…
- Élargissement des modalités et
formes de monstration, de réception
de l’oeuvre : diversité des relations
entre oeuvre et spectateur de la
contemplation à l’action…
- Créer à plusieurs plutôt que seul
- Oeuvre collaborative : partenaires, artisans
fondeurs et assistants en Chine et en France
- Oeuvre collaborative : partenaires, artisans
fondeurs et assistants en Chine et en France
- Dictionnaire historique de la langue française. Éd. Le Robert. NATURE n.f est emprunté (119) au latin
natura, dérivé de natus « né », participe passé de nacsi (naître). Natura signifie proprement « fait de
naître, action de faire naître » et de là « origine, extraction, caractère inné, naturel » (également au
figuré). Par la suite, le mot désigne aussi plus largement l’ordre des choses traduisant alors le grec
phusis (physique). En philosophie, natura traduit également le grec phusis au sens « d’élément,
substance ». Enfin, Il est employé par métonymie pour désigner les organes de la génération. Nature,
dans les premiers textes, a le sens de « force active qui établit et maintient l’ordre de l’univers »,
souvent personnifiée avec une majuscule ainsi que dans certains emplois, comme la locution payer le
tribut à la nature, « mourir » (1688). Dès le XIIème s, le mot désigne l’ensemble des caractères, des
propriétés qui définissent les objets (v.1120) et les attributs propres à l’être (11
- Dictionnaire historique de la langue française. Éd. Le Robert. PAYSAGE n.m. est dérivé de pays avec le suffixe
-age (1549). C’est un terme de peinture désignant la représentation d’un site généralement champêtre, puis le
tableau lui-même : Richelet (1680) signale que les peintres prononcent pésage, la prononciation moderne étant
alors réservée aux profanes. Dans l’histoire de la peinture européenne, le traitement du paysage comme thème
pictural principal est une création de la Renaissance (fin XVe-XVIe s. Mantegna, Dürer, Leonard, Bruegel) et doit
beaucoup aux études cartographiques et à l’amplification de motifs liés aux attributs de la Vierge (plaine bien
cultivée, champ non labouré, puits, pont, château, village, nuage). Par métonymie, le mot désigne dès le XVIe s.
l’ensemble du pays, le pays (1556). Avant la fin du siècle, il désigne couramment l’étendue de pays que l’œil peut
embrasser dans son ensemble (1573) et c’est cette valeur visuelle qui l’a emporté.
- Dictionnaire historique de la langue française. Éd. Le Robert. LIEU n. m. attesté en ancien français sous les formes loc. (Xe s . ) , leu (1050) puis lieu ( vers 1120) est issu du latin locus « lieu, place, endroit » qui sert à traduire le grec
topos (topo; isotope, topique, utopie) et en a repris les sens techniques (médecine, littérature) et rhétoriques. Locus a également reçu le sens figuré de « situation, rang ». Son étymologie n'est pas claire. Lieu, apparu avec son sens
général de « portion déterminée d'espace », est aussi pris spécialement dans lieu saint (v.1150) « temple, église » dont le pluriel les lieux saints est attesté ultérieurement pour désigner les lieux de la vie de Jésus en Palestine. La
plupart des sens du mot sont apparus au XVIe s. et en langue classique: il entre dans lieu public (v.1538) employé en géométrie.
- Dictionnaire historique de la langue française. Éd. Le Robert. SITE n. m. attesté vers 1303, est issu du
latin situs « position, situation », spécialement en parlant d'une ville, et « situation prolongée », d'où «
état d'abandon, jachère », aussi « moisissure, rouille », «saleté corporelle » Site est d'abord dit pour «
place, emplacement ». Il n'est ré attesté qu'en 1347, puis en 1512, spécialisé depuis le XVIIe s. (1660,
d’Aubigné, texte posthume ; site d'une place de guerre) au sens de « configuration d'un lieu, du
terrain, où s'élève une ville, manière dont elle est située au point de vue de son utilisation par
l'homme ». Par ailleurs, le français de la Renaissance a emprunté à l'italien sito le sens de « partie de
pays considéré du point de vue pittoresque, de l'esthétique », valeur employée depuis le XVIe s.
(1580, Montaigne) pour parler de la disposition générale des éléments d'un paysage.
Recursos multimedia adjuntos
- Serpent Mer4 (binary/octet-stream)
- Huang+Yong+Ping,+Serpent+D'océan.+©Gino+Maccarinelli.+2012 (binary/octet-stream)
- Prog Hyp (binary/octet-stream)
- Spiral Jetty (binary/octet-stream)
- Christo Surrounded Islaneds (binary/octet-stream)
- Brancusi (binary/octet-stream)
- Liubolin (binary/octet-stream)
- Kruger Moca (binary/octet-stream)
- Ursfischer5 (binary/octet-stream)
- Ursfischer3 (binary/octet-stream)
- Ursfischer4 (binary/octet-stream)
- Ursfischer2 (binary/octet-stream)
- Ursfischer (binary/octet-stream)
- Oldenburg (binary/octet-stream)
- Oldenburg2 (binary/octet-stream)
- Oldenburg3 (binary/octet-stream)
- Mobile Matrix (binary/octet-stream)
- Capture+D’écran+2020 11 28+À+17.41.33 (binary/octet-stream)
- Hyp Processus (binary/octet-stream)
- Spectacle Royaldeluxe (image/png)
¿Quieres crear tus propios Mapas Mentales gratis con GoConqr? Más información.